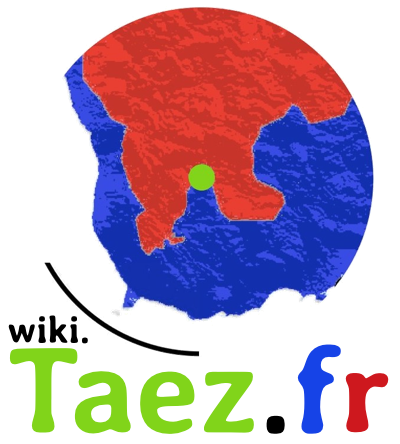Table des matières
Un premier cours possible…
Premier jet le 10 mai 2023 : Dans la perspective où je serais amené à enseigner au Maroc, je commencerai forcément par un premier cours expliquant d’où je parle, l’articulation entre mon expérience au Yémen et les idées générales du cours.
Thème du cours : un cours de sciences sociales, sur les sciences sociales, et sur leur rapport avec l’islam.
Public du cours : Le cours s’adresse à des étudiants marocains, soit des musulmans implicitement, même si l’ensemble du cours est construit sur un registre laïque.
Objectif du cours : Faire prendre conscience de la condition intellectuelle spécifique du musulman dans son rapport aux outils des sciences sociales, en fait de tous les outils hérités des sciences européennes.
Introduction : l’instabilité de la signature sociologique
Le point fondamental que j’aimerais introduire ici, et qui parcourt tout ce que j’ai à dire sur les rapports entre islam et sciences sociales, concerne l’instabilité fondamentale de la signature sociologique - ou si l’on préfère, l’instabilité de la position énonciative des sciences sociales (voire des sciences en général, là encore).
(Explications théoriques rapides) : Pour un musulman, il n’y a pas de loi sociologique stable - le croire équivaudrait à une forme de shirk ou d’idolâtrie*. Mais de toute façon, la pratique des (bonnes) sciences sociales repose toujours sur une activité de lecture critique et un effort intellectuel, qui consiste justement à retrouver qui parle, à ressaisir l’énonciation de l’auteur dans son caractère dynamique ou évolutif, dans son instabilité. Tout proposition sociologique (voire philosophique) est prise dans le flux du temps. Elle doit être rapportée à la configuration historique de son énonciation, à son historicité. En tous cas c’est comme ça que je travaille, c’est cette activité qui raffermit ma foi, et c’est ce que j’aimerais transmettre.
Mais pour commencer, je voudrais décrire les circonstances qui m’ont permis d’acquérir cette compréhension des sciences sociales, et de m’épanouir intellectuellement comme anthropologue-musulman*.
Je parle d’abord des circonstances historiques : mon enquête dans les dernières années du régime républicain au Yémen depuis 1962, avant le tournant de 2011, l’effondrement ultérieur qui est définitif. J’aimerais vous expliquer comment ce Régime m’a confronté à la fragilité de l’analyse sociologique, au caractère transitoire de nos visions du monde, mais m’a permis aussi de m’installer dans cette fragilité, de vivre avec - il m’a appris à devenir musulman.
Je parle ensuite des circonstances humaines et relationnelles : le type de rapports dans lequel j’ai été plongé avec mes interlocuteurs, du fait de l’instabilité du régime et des sciences sociales elles-mêmes. Le type de dette que j’ai contracté à leur égard.
(1) Les Printemps Arabes et la théorie des types logiques
(partie non développée ici)
Evocation du Printemps Arabe depuis le monde de la recherche sur le Yémen.
Description de ma recherche à Taez (les interactions de la sociabilité masculine et leur dimension genrée, que je cherche à interpréter en lien avec l’histoire sociale). Recherche un peu expérimentale et spécialisée, marginale par rapport à l’organisation générale des études yéménites.
En 2011, Taez fait irruption au centre de la scène, et bouleverse cet ordre catégoriel (par rapport au type de changement décrit par les sciences sociales, c'est un niveau de changement plus abstrait).
Je renonce à soutenir ma thèse dans ces conditions.
(2) Mon rapport au régime
(= le lien entre ma conversion à l’islam et une « transaction sexuelle » survenue à la fin de mon premier séjour.)
Introduction : L’ethnographe et les sciences politiques face au « Régime »
Quand je parle du Régime, je parle de deux choses qui sont étroitement liées :
- un régime politique (sens n°1 : l’organisation des institutions au sein d’un État) ;
- un régime épistémologique (sens n°2 : l’organisation des catégories au sein d’une démarche de connaissance).
Bien sûr, les sciences politiques ont leur propre manière de décrire le « régime » de tel ou tel État : régime parlementaire, théocratique, autoritaire ou dictatorial, fasciste, démocratique…
Mais il est un régime dont les sciences politiques ne parlent pas, par définition : c’est le régime qui permet la présence de l’observateur, et constitue l’organisation politique en objet. Les sciences politiques discutent en surplomb, mais leur existence-même n’est pas discutée.
Or en tant qu’ethnographe, on est confronté à ça. L’ethnographe, c’est précisément celui qui va en personne sur le terrain, pour éprouver personnellement les conséquences du rapport scientifique qu’il prétend instaurer.
Cette habitude des anthropologues qu’on appelle « le terrain », elle a une histoire qui remonte au début du XXème siècle, à la première guerre mondiale et à un anthropologue, Bronislaw Malinowski…
J’insisterai ici simplement sur un point : l’histoire du terrain se joue sur des terrains « exotiques » hors de l’aire culturelle monothéiste, et c’est seulement par accident que cette démarche est rapatriée sur des pays arabes tels que le Yémen (le pays de la reine de Saba, il n’y a pas plus monothéiste…) - à cause de la disgrâce de l’Orientalisme, qui va de pair avec les Décolonisations.
Le dénouement de mon premier séjour
Donc en 2003 « je vais sur le terrain », muni de cette méthode d’enquête qu’on appelle l’ethnographie* : je passe trois mois en « immersion » dans la société yéménite (juillet-octobre 2003), puis je rentre pour rédiger mon mémoire de maîtrise.
…Sauf que dans les trois dernières semaines de ces trois mois, je suis engagé dans une « transaction sexuelle » : une relation qui se passe hors de Taez et dont je ne parlerai pas dans mon mémoire, que je n’ai même pas consignée dans mes notes quotidiennes (j’ai arrêté de tenir mon carnet précisément à ce moment là), mais qui impliquait des rapports sexuels réguliers, au vu et au su de mes principaux interlocuteurs.
Cette transaction sexuelle était tellement acceptée, elle faisait tellement consensus, que neuf mois plus tard après le dépôt de ma maîtrise, et alors que je me prépare à retourner sur place, c’est l’idée d’homosexualité qui me tranquillise… Après tout, ça aurait pu être l’inverse, étant donné le statut légal de l’homosexualité dans ces pays, j’aurais pu avoir peur ! Mais c’est exactement l’inverse : je me convertis subjectivement à l’homosexualité parce que je veux retourner là-bas. Je me dis : « Tout va bien se passer, puisque tu es homosexuel » - comme si l’homosexualité était le lien qui me reliait à cette société. En réalité ce lien était l’islam, pas l’homosexualité, mais c’est cette énigme qui m’a accompagné dans l’enquête, jusqu’à mon arrivée à bon port.
Cette situation a évidemment un rapport avec le Régime, dans les deux sens distingués ci-dessus.
Dimension politique
D’abord dans le sens n°1, de manière très ordinaire : mon partenaire dans cette transaction sexuelle est un cousin de mes interlocuteurs qui appartient à une branche dominante de la famille, du point de vue de son ancrage dans le Régime. C’est la branche de Sanaa, celle qui a des relations dans la Capitale, dont les membres ont fait des études à l’étranger, qui ont des postes stables… Le jeune homme en question a grandi à Taez, il a fini ses études secondaires, puis on l’a appelé à Sanaa et on l’a mis derrière un bureau… Alors que la branche de Taez, qui sont mes interlocuteurs, sont dans des boulots beaucoup moins stables, qu’ils obtiennent sur le mode de l’adversité - que ce soit comme chef de la police des souks (Nabil), comme expert comptable et contrôleur financier (Ziad), ou encore comme ouvrier ordinaire (Yazid).
Évidemment, une telle situation est un affront à l’honneur, une affaire grave du point de vue yéménite. Imaginez une famille qui reçoit un hôte, et une autre famille du même clan qui vient chercher cet hôte, qui le courtise, et instaure finalement avec lui des rapports de ce genre… Dans la logique yéménite, c’est évidemment un affront à l’honneur de la première famille. Et cet affront est possible seulement parce que la deuxième famille jouit d’une position plus élevée dans le Régime.
Dimension épistémologique
Ceci étant posé, il faut aussi prendre en compte le régime au sens n°2 : le régime épistémologique des sciences sociales, et c’est là que les choses deviennent intéressantes. Car je suis partie prenante de cette histoire : même si les Yéménites vont la lire en termes d’honneur, l’affront d’une famille à une autre à travers son hôte, je ne suis pas juste un acteur passif de cette histoire : pour le dire très clairement, je n’ai pas été violé. Si l’on y regarde de plus près (comme j’ai pu le faire par l’écriture ces toutes dernières années)1), comment cette transaction sexuelle s’est-elle mise en place ?
Quelles sont les circonstances de ce « rapt », et d’abord, comment ce cousin se débrouille-t-il pour me « courtiser » et m’attirer à Sanaa - alors que mon terrain est à Taez, et qu’il me reste seulement trois semaines avant mon vol retour ?
C’est très simple : il se positionne comme informateur, comme une personne disposée à me parler, à combler les lacunes de mes observations en me livrant les informations qui me manquent, et finalement m’expliquer ce que je n’arrive pas à comprendre par moi-même. Le cousin de Sanaa se place dans une position surplombante à l’égard de la situation que j’ai pris pour objet.
⇒ Donc parmi les circonstances de ce « rapt », il y a les sciences sociales : ce processus de transcription écrite d’une situation sociale, passant d’abord par des notes de terrain, ensuite par leur synthèse a posteriori.
Mais justement, je n’arrive pas à faire cette synthèse : au moment où le cousin de Sanaa entre en scène, le processus est enlisé. La phase du terrain est clairement terminée, les acteurs se sont dispersés, et moi je n’arrive pas à donner sens à ce dont j’ai été témoin. À ce stade, je ne vois absolument pas quel mémoire je vais pouvoir écrire. C’est pourquoi j’ai besoin d’un « informateur ».
⇒ Autre circonstance à prendre en compte, c’est la sincérité du cousin de Sanaa. Il ne faut pas croire que ce cousin utilise les informations dont il dispose, avec l’intention de me dominer sexuellement : ce n’est pas du tout ça qui se passe !
L’aliénation du diplômé
Ce cousin n’est pas différent de vous : c’est un jeune homme qui a grandi quelque part, qui a quitté ce quartier pour travailler dans un bureau, et qui souhaite maîtriser son histoire. Lui-même cherche à entretenir ce rapport distancié au quartier dans lequel il a grandi : il veut continuer d’en être malgré son exil, et il veut maîtriser la manière dont il en est, intellectuellement. C’est pourquoi il y a pour lui un enjeu réel à participer à l’enquête, un enjeu existentiel.
Seulement, il ne comprend pas : pendant 48h, nous discutons à bâtons rompus, mais il ne comprend pas ce à quoi j’ai assisté, ce que je cherche à montrer. Et finalement une nuit, Satan lui murmure une explication : Satan lui dit qu’il a été naïf, qu’en fait le Français cherche juste à mettre en place un rapport sexuel. Du coup il décide de me prendre au réveil pour me tester : après la prière de l’aube, il vient me réveiller depuis la porte de ma chambre, et brusquement il me demande si je ne suis pas homosexuel, c’est-à-dire si je n’aurais pas une intention sous-jacente, derrière nos discussions…
Evidemment la réponse est non : je ne suis pas du tout en train de chercher un rapport homosexuel, pourtant je lui saute dessus !
Oui, c’est moi qui lui saute dessus… Pourquoi ? Parce que je suis dans une situation d’impasse. Cela fait deux mois que j’évolue dans la société yéménite en mettant cette question à l’écart - en refusant d’interpréter sexuellement des situations qui pourraient passer pour ambiguës - mais malgré cela je me rends compte de mon échec. Je me rends compte que je n’ai pas réussi à m’intégrer, que la société s’est refermée, qu’elle s’est recroquevillée dans sa coquille. Et en fait je ne peux pas admettre ça, parce que j’ai trop investi, j’ai fait trop de sacrifices pour devenir anthropologue, et je ne peux pas admettre que je ne sais rien, que je n’ai rien appris.
C’est dans ces circonstances qu’une forme d’intimité s’installe entre nous - qui découle en fait d’un quiproquo, ou plutôt de nos contradictions respectives.
Conclusion
Dans ma subjectivité, l’homosexualité a été nécessaire, pour que je consente à assumer un point de vue : pour assumer le caractère fictionnel de mon analyse sociologique, pour assumer sa fausseté.2)
C’est pourquoi le rapport se répète les trois semaines suivantes, jusqu’à ce que je monte dans l’avion. Waddah comprend qu’il s’est trompé, il voudrait que nos rapports évoluent. Mais il ne peut rien y faire, il m’a donné l’occasion d’affirmer ma subjectivité : vis-à-vis de lui, de son quartier, de la société yéménite en général. Il ne peut pas me convaincre que c’est mal, alors qu’il m’a fait cette proposition. Il ne peut pas me tourner le dos, car je ne manquerais pas de retourner à Taez. Il peut juste constater le paradoxe, et tenter de se comporter le plus dignement possible.
En fait ce qui se joue dans cette relation, ces trois semaines à la fin de mon premier séjour (octobre 2003), c’est le premier arrachement au terrain, et aussi le premier passage à l’écriture. C’est le moment où je m’installe dans une signature, c’est-à-dire l’affirmation d’un « moi » parmi les choses du monde.
Mais c’est une signature éminemment instable, du fait-même de ces conditions. Huit mois plus tard, une fois le mémoire déposé (juin 2004), je quitte ma copine et je me déclare homosexuel. Car au terme de ce premier travail, j’ai le sentiment d’avoir menti, de m’être menti (comme une personne qui « nie son homosexualité »). Je veux retourner sur place, renégocier ma signature. En apparence je prendrai d’autres objets d’étude (la condition sociale des ouvriers journaliers, puis le rôle de la vulgarité dans la socialité des commerçants), mais en fait je fais le choix de rester au même endroit, aux prises avec la même situation ethnographique. J’essaie de percer un secret.
Le secret, c'est cette instabilité fondamentale de la signature sociologique, avec laquelle je vais devoir apprendre à composer. Le secret, c'est qu'il n'y a de stabilité qu'en Allah.