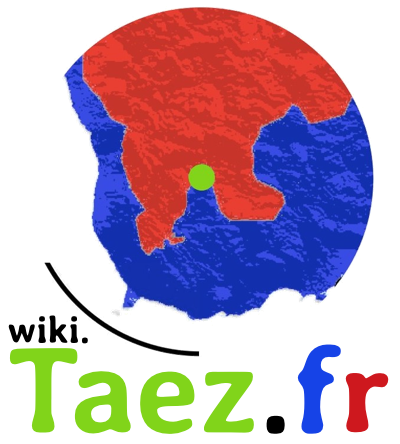Table des matières
Générations
Quand je pense à ma vie avant l’anthropologie, avant surtout le départ sur le terrain, je ne vois pas une grande personne, un homme adulte en pleine majorité. Je vois un enfant, ou même pas : une larve. Sans doute bien des anthropologues vous diront la même chose, c’est un peu inhérent à notre métier. Pour autant cette illusion est un piège, qui a des effets épistémologiques bien réels1). Au contraire, l’anthropologue doit assumer l’intelligence qu’il emporte avec lui sur le terrain, autant que possible : partir du principe qu’il était pleinement conscient de ses actes, même s’il ne parvient plus à en rendre compte rétrospectivement.
Étapes sur le chemin
Quand j’ai décidé de faire de l’anthropologie, je n’étais pas une larve mais je venais de perdre mon père. On lui avait découvert un premier cancer en 1994, quand j’avais quatorze ans. Le cancer était indolore, son traitement ultérieur l’avait fatigué mais je n’en ai pas beaucoup de souvenir, et le cancer était censé être guéri. Au printemps 1998, quand j’étais en Terminale, mon père avait commencé à ressentir des douleurs. Un mois après les résultats du bac, le diagnostique était tombé : il ne lui restait que peu à vivre, entre six mois et deux ans. Il a vécu onze mois, coïncidant avec ma première année de classe préparatoire : année au cours de laquelle j’ai commencé à apprendre l’arabe, frénétiquement, aux côtés d’un camarade Tunisien. Deux semaines plus tard (juillet 1999) je me retrouve à Sfax, tout seul dans la famille de Momo. Inconsolable, mais avec des hommes enturbannés qui s’émerveillent de mes moindres gazouillis, comme les rois mages penchés sur le berceau…
Je me rends pour la première fois au Yémen deux ans plus tard (juillet 2001), avec la classe d’arabe de l’Ecole Normale Supérieure. Deux ans au cours desquels j’ai beaucoup réfléchi, beaucoup mûri, comme on mûrit entre dix-neuf et vingt-et-un an. Je suis alors fonctionnaire de l’État Français, sur la voie royale pour devenir physicien comme mon père… sauf que je ne suis pas mon père. Par exemple, je parle un peu arabe, je pratique la photographie amateur. À partir de ces quelques petites choses que mon père ne faisait pas, je commence à construire ma propre voie. L’automne suivant, je m’apprête à commettre le « casse du siècle » : m’inscrire au département de sciences sociales, troquer mon statut de Normalien physicien pour un statut de Normalien littéraire, comme si j’étais moi-même passé par la khâgne et l’hypokhâgne… Je me rendais bien compte que ça allait poser problème - et c’est bien la preuve que je n’étais pas une larve, que j’avais déjà quelques connexions neuronales bien actives. Ma reconversion commence par une sorte de bluff, que je pousse autant qu’il est possible, notamment devant les étudiantes littéraires de la classe d’arabe. À l’époque je n’étais pas une larve, mais j’étais encore puceau2). Je n’arrivais pas à sortir de ce deuil, comme si ce cancer était un peu le mien. Alors me reconvertir aux sciences sociales ? Cette discipline confuse, à peine scientifique ?? Ce geste n’allait m’attirer que des problèmes, je m’en rendais bien compte. Mais en même temps, j’avais à l’oreille la petite chanson : « Andy a toujours évité les ennuis… ». J’avais sous les yeux le ciel New Yorkais, les tours en flammes, s’effondrant dans le grésillement des écrans de télévision. Mon père était bel et bien mort, fauché par cette chose irréelle, impensable. Je ne pouvais pas rester là comme un benêt, indéfiniment - et pour attendre quoi, que mon père revienne ??
Encore deux ans plus tard (octobre 2003), il y a cette mystérieuse transaction sexuelle, dans les dernières semaines de ma première immersion à Taez, avec un cousin de mes interlocuteurs exilé à Sanaa. Transaction sur laquelle j’ai maintenant beaucoup écrit (depuis 2017), dont j’ai montré qu’elle avait ouvert la voie à la rédaction de mon premier mémoire. Et quatre ans plus tard, enfin, il y a ma conversion à l’islam (septembre 2007), qui met un terme au terrain de ma thèse, peu après que Ziad ait mis le feu à sa propre maison.
La configuration* est posée : Ziad al-Khodshy, mon père Richard Planel,
ainsi qu’une succession de dates : juin 1999, octobre 2001, octobre 2003, septembre 2007.
Une succession de gestes, prises de positions entraînant changement de statut : le geste qui fait de moi un littéraire, celui qui fait de moi un homosexuel, et celui qui fait de moi un musulman. Ces gestes s’enchaînent dans une progression logique, et aucun ne relève d’un accident. Chaque sas que j’ai franchi, je l’ai franchi en pleine conscience, après mobilisation de toutes mes facultés mentales. Parce que chaque prise de position, sur le moment, a réactivé en moi la première de toutes : avoir vu mon père mourir. Geste qui n’invite en lui-même à aucune repentance, à aucun regret, ça n’a strictement aucun sens.
Et pourtant, cette configuration ne passe toujours pas. Nous sommes aujourd’hui en 2025, et jusqu’à ce jour, aucune institution française n’a accepté le pacte que je lui propose, que nous leur proposons depuis presque dix-huit ans : racheter ma dette envers Ziad.
Le service des institutions
Mon père Richard Planel a passé sa vie au service des institutions. Polytechnicien, il a fondé un laboratoire de recherche en semi-conducteurs, participé aux instances nationales du CNRS, rédigé des manuels d’enseignement des sciences à l’école primaire, noué des collaborations scientifiques avec de nombreux pays étrangers. Son père Robert Planel3), fils d’un petit marchand de musique de Montélimar, a fait carrière comme Inspecteur Général à l’Enseignement Musical du Département de la Seine, pendant les trois décennies d’après-guerre. Sa mère Jacqueline Planel, née Carray, professeure de musique et musicologue, était la fille d’un instituteur protestant de Besançon, accessoirement vétéran de la Grande Guerre. Oui ils sont tous morts, et alors ? Que Diable attendez-vous de me voir confesser ?
Faut-il que je confesse quelques envolées lyriques quant à mes sentiments envers Ziad, couchées sur mon carnet de terrain dans les premiers jours de notre rencontre ? Oui c’est vrai, j’ai bel et bien écrit ces lignes :
« Ouf, ça s’accélère, j’en ai un peu mal à la tête. Ce pays cesse d’être un domaine d’observation. Me voilà pris dans une relation forte, d’une rare intensité, comme mon amitié avec Brice ou avec Momo [mes deux amis de prépa]. Ziad me fascine. Non seulement parce qu’il est intelligent, fin, beau aussi. Il y a en plus une relation forte de séduction, et une invitation forte de sa part à aller plus loin. »
Et aussi un peu plus loin :
« Du point de vue de l’enquête, ce sera intéressant de plonger dans ce milieu de quartier, avec un poste. Zyad est un allié*. Je peux lui parler du fond de mon sentiment, de mes questions sur les gens. On partage une complicité qui nous éloigne des autres. Déjà, hier, je pensais (avec une dose de fantasme) que cette recherche serait la sienne, que ce serait lui qui m’en ferait cadeaux. Je serai le pont par où pourra s’échapper ce regard exceptionnel. »
C’était le 17 août 2003. Je sortais à peine d’une première discussion avec Ziad de trente-six heures, à bâtons rompus.4) Déjà le cap était fixé.
Oui c’est vrai, j’ai voulu croire en l’intelligence de Ziad. Et j’ai tenu bon par la suite : je ne l’ai jamais considéré comme un voyou, un fondamentaliste ou un psychotique définitivement - même si je lui ai fait porter tour à tour ces différents vêtements.
Oui c’est vrai, j’ai aussi écrit sur cette même page : « Zyad me fascine parce qu’il a cette solidité entière et cohérente des fous. ». J’ai écrit ailleurs qu’il était « un voyou », qu’il était un « fou de Dieu ». À ce jeu-là, vous trouverez toujours une ligne de mes carnets, la tournure de phrase de l’un de mes textes, pour justifier ce que vous voulez penser. C’est pourquoi à la fin (décembre 2017), j’ai fini par tout mettre en ligne, textes et carnets : régalez-vous !
Flash back
« C’était un samedi matin au début du mois de juin. Normalement le samedi, c’était quatre heures de devoir sur table, mais là les notes s’étaient arrêtées. Nous avions un cours normal avec le prof de physique, quand la directrice frappe à la porte. Elle appelle mon nom. En rassemblant mes affaires je me tourne vers Momo, qui me regarde impuissant. Quelques instants plus tard je cours vers l’Institut Curie.
Pendant la nuit dans sa chambre d’hôpital, mon père a fait un accident vasculaire cérébral. Il s’est vidé dans son lit et débattu dans sa merde. Ma mère l’a trouvé comme ça à son arrivée, inconscient. Elle l’a nettoyé avec l’aide de l’infirmier, mais ses mains sentent encore. Mon père a les yeux fermés. On nous explique que c’est la fin, les médecins lui ont injecté des sédatifs pour qu’il ne souffre pas. Mes sœurs arrivent, ma grand-mère, et ma tante qui vit à Tunis va arriver dans l’après-midi. Nous sommes tous réunis autour de lui. Nous attendons.
Le dimanche, mon père a les yeux ouverts. Les mains agrippés sur les barrières de son lit, la tête relevée, il regarde devant lui. On dirait qu’il entend mais il ne réagit pas. Il reste comme ça toute la journée. Ma sœur et moi sortons nous changer les idées, elle visite le lycée où se trouve Momo. C’est une drôle d’ambiance, le temps est comme suspendu.
Le dimanche soir ma mère rentre dormir, car elle travaille le lendemain. Nous restons veiller sur lui ma sœur et moi. Au milieu de la nuit il commence à parler. Il me demande ce que je fais en ce moment. Je lui parle de la prépa, de Mohammed. Il a tout oublié - il croit que je parle d’un ami de ma tante - mais il ne veut rien laisser paraître. Il est redevenu tel qu’un an plus tôt, avant de se savoir condamné. Il a retrouvé son caractère strict et exigeant, et il me fait la morale comme avant, comme un père à son fils adolescent. C’est à pleurer.
Toute la journée les visites se succèdent. Les gens viennent échanger avec lui les dernières paroles, et il fait bonne figure. Lui qui se croit dans la fleur de l’âge, il se retrouve dans un lit d’hôpital avec un corps de vieillard, et une phlébite à sa jambe qui a doublé de volume. Toute la journée, il scrute les visages éplorés de sa mère, de sa sœur, de sa première fille. Le soir quand ma mère arrive, la question fuse dès qu’ils se retrouvent seuls : « Qu’est-ce que tu m’as fait ? Tu m’as empoisonné, ça ne peut être que cela ! » Quand elle s’effondre devant lui, il est forcé d’admettre la réalité. Il doit renoncer encore à sa vie, cette fois en quelques jours. Le jeudi nous fêtons ses 51 ans, avant que ma tante ne reparte pour Tunis. Il reste digne mais d’humeur bougonne, il s’absorbe dans son travail. Il meurt trois semaines plus tard, au centre de soins palliatifs.
Extrait de mon texte Déconfinement : récit autobiographique (1998-2004) et essai de généalogie familiale, rédigé du 4 avril au 11 mai 2020.
Sur ce wiki, l’AVC de mon père est déjà évoqué dans La bulle (notice de mars 2022).
Qu’attendez-vous que je confesse, à part le fait d’avoir vu mon père mourir ? De n’avoir rien manqué de ce spectacle, de l’avoir enregistré dans ses moindres détails, et d’en avoir conçu une sorte de boussole…
Mon père était cet homme né en 1948, dans une Europe en ruines. Né d’un musicien déjà au faîte de sa carrière, mais récemment veuf de sa première épouse, qui n’avait jamais pu lui donner d’enfant. Il est né d’une jeune musicienne rayonnante et dynamique, récemment débarquée dans la Capitale, et prise pour épouse par l’Inspecteur Général… Mon père est né, juste parce qu’il fallait bien renaître. Il fait partie de cette génération qui ne devait rien à personne, et qui a prétendu réinventer les règles : la « génération 1968 », comme on la caricature souvent. Mais il n’y a rien à caricaturer : tout au cours de sa vie, peut-être relativement courte, mon père a su progresser avec intelligence ; une force d’analyse doublée d’une force d’amour. La bienveillance pour tout ce qu’il comprenait, et de l’humilité face à ce qu’il ne comprenait pas.
Or malgré toute cette intelligence, au solde de tous comptes, il n’était pas apaisé. Sa mère voulait le voir enterré dans le Sud de la France, auprès de son défunt époux l’Inspecteur Général, décédé cinq ans plus tôt. Ma mère refusait fermement : mon père serait enterré au Sud de l’Île-de-France, là où nous partions les week-ends. Les deux femmes campaient sur leurs positions, incapables du moindre compromis. Tragédie cornélienne, bourgeoise sans doute et néanmoins universelle : une tragédie de la condition masculine. Mon père savait qu’après son départ, sitôt la terre retombée sur son cercueil, chacune repartirait avec sa propre version des faits.5) Cette situation le rendait malade, comme si le cancer n’avait jamais eu d’autre cause : il ne pouvait se résoudre à partir comme ça. Avec toute cette force d’analyse et cette force d’amour, il a trouvé les moyens de cette ultime pirouette : mourir en se débattant dans sa propre merde, comme une ultime leçon de choses transmise à son fils.
Un espoir aveugle
Le samedi 5 juin 2004, j’ai quitté l’appartement de ma petite amie, sans me retourner, en fin de matinée. J’avais déposé la veille mon premier mémoire (centré sur Ziad), j’allais repartir au Yémen le mois suivant : il valait mieux que cette histoire s’arrête. Quelques semaines plus tard, par une nuit sans sommeil, je replongeai dans mes souvenirs de cette année fatidique. Le jeudi nous avions fêté son anniversaire, donc c’était bien le samedi 5 juin, en fin de matinée, cinq ans après jour pour jour ! J’ai pris cela comme un signe. Bien qu’il n’en ait jamais rien su lui-même, mon père était homosexuel. Et voilà toute mon appréhension subitement évaporée, à la perspective de mon retour dans ce pays lointain…
S’il faut confesser une chose, c’est l’incroyable espoir suscité dans ma famille par cette improbable conversion. Qu’on déclare homosexuel un mort, cinq ans après sa disparition, personne n’était là pour s’en offusquer. Ma grand-mère avait déjà perdu la tête, et ma mère voulait passer à autre chose, comme tout le monde en fait. Formidable espoir que le fils retourne là-bas, après y avoir trouvé tant d’intelligence et d’amour, manifestement. Il fallait que la vie continue. C’était il y a plus de vingt ans, très exactement : vingt ans et neuf mois.
Les générations se succèdent, elles ne peuvent toutes avoir leur place dans cette histoire. Oui bien sûr, ma famille n’est pas innocente, mon milieu d’origine, ma société. Bien sûr d’autres facteurs sont intervenus, pour conduire au blocage présenté ici - pas seulement la mort de mon père il y a vingt-cinq ans. Mais il fallait tracer une ligne, au-delà de laquelle on n’écrirait plus : ma conversion à l’islam a eu cette fonction. Pour que les générations puissent vivre, il faut que les institutions prennent sur elles. Qu’elles renoncent à la tyrannie de l’écriture, de la surveillance, la tentation omnisciente : que les institutions renoncent à donner la vie. Ce renoncement passe par les « musulmans diplômés »*, ceux que je critique presque à chaque page de ce site, du sein de la grande famille de l’islam.
Et bien sûr, je n’oublie pas que ma famille biologique n’a toujours pas accueilli Ziad, ni mon milieu d’origine, ni ma société. Elle m’accueille moi, et c’est déjà énorme. Moi qui ne serai plus jamais une larve, et plus jamais un papillon, mais qui tisse tout de même mon cocon de ver à soie, à travers les fils de ce wiki. Elle m’accepte là où je suis, petite boule informe posée sur une branche, qu’on ne comprend pas très bien. L’Europe est comme ça, tolérante autant qu’elle est aveugle. Il faut cesser de prétendre lui ouvrir les yeux.
(Rédigé le 10 avril 2025)