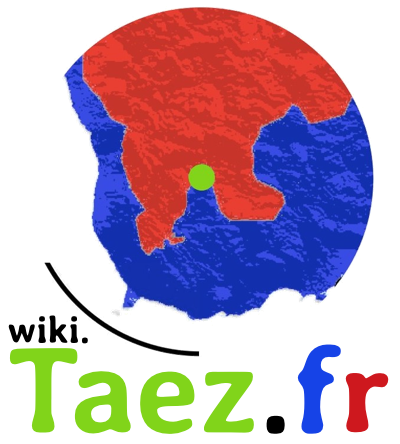Ceci est une ancienne révision du document !
Pour un souverainisme inclusif
L’anthropologue et démographe Emmanuel Todd, dans son entretien du 23 juin 2024 (hier), pressent deux issues possibles à la dissolution provoquée par Emmanuel Macron : soit par le bas, avec une alliance Macron-RN ; soit par le haut, avec une alliance RN-NFP (« l’alliance des extrêmes » dans le langage des médias). Il évoque la convergence des programmes économiques, et constate que le seul obstacle réside dans la question du rapport obsessionnel à l’islam. Il prône un souverainisme inclusif, remarquant la confusion caractéristique du RN entre les migrants de fraîche date et l’immigration ancienne, de sorte qu’il suffirait de réintroduire cette distinction. Tout en admettant le caractère peu probable de cette hypothèse, il pressent que Macron ferait une excellente « victime expiatoire », en vue d’un rituel de réconciliation collective de la société française avec elle-même.
Je partage cette perspective, et j’aimerais contribuer à sa réalisation par la remarque suivante. Outre la nécessaire distinction entre migrants de fraîche date et immigration ancienne, ce souverainisme inclusif exige de réhabiliter la figure du converti, particulièrement honnie en France - notamment par les élites intellectuelles de gauche (sauf quand le converti se folklorise lui-même en se réclamant du « soufisme »). Il faut défendre celui qui, dans certaines circonstances, attache son destin à la communauté musulmane globale (oumma) ; le défendre notamment contre l’intérêt structurellement antagoniste des musulmans diplômés*, qui flattent la « validité universelle » des disciplines qu'ils adoptent, neutralisent certaines de leurs facultés réflexives, et rendent ainsi possible la dérive macroniste des éduqués supérieurs. Je rappelle la présence tout à fait banale des convertis à l’époque coloniale, y compris dans les milieux intellectuels, leur pleine participation à une conception supranationale de l’identité française.
Bref, il faut restaurer la figure du converti dans son universalité. Afin d’y parvenir, j’aimerais prendre appui une fois de plus sur Ani Difranco : souligner la gémélité de nos trajectoires respectives, en traduisant cette courte interview du 23 février 1994.
Ani à 23 ans
Ani Difranco est interviewée par Harold Channer (1935-2020), infatigable explorateur des avant-gardes new-yorkaises pour la télévision locale.
L’interview dure les 11 premières minutes. Les passages les plus pertinents sont vers 3:23, puis vers 7:43.
Traduction sous peu.
Ani a alors 23 ans - l’âge que j’avais en octobre 2003, au retour de mon premier terrain à Taez. Je reprends totalement à mon compte la manière dont elle justifie la dimension autobiographique de son travail, sur le thème du personnal is political. L’argument est absolument transposable pour l’ethnographie réflexive, notamment pour la démarche multisite* du circumstantial activist, qui a été largement théorisée. Tout ce que je demande, c’est qu’on envisage la réalisation de cette démarche dans l’islam : que les sciences sociales consentent à entériner les contraintes structurelles mises en évidence par mon récit, quitte à envisager le retrait de l’observateur. Ou concernant Ani, ne pas figer son image en 1994, mais y décèler déjà une certaine sagesse : celle qui la conduira, une quinzaine d’années plus tard, au repli assumé sur la sphère privée.
⇒ Ani Difranco (page d’accueil du dossier)
Accueil du Wiki
fr:valoriser:scenographie:ani_difranco:ani_a_23_ans