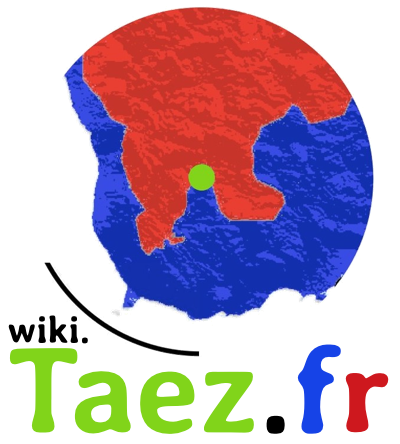Table des matières
Le badge du Président
Le 4 décembre 2017, Ali Abdallah Saleh est mort. Il était arrivé au pouvoir en 1978, deux ans avant ma naissance, dans un pays dont je n’ai connu l’existence qu’à l’âge de dix-huit ans (parmi une liste de pays où l’on parlait l’arabe). Cinq ans plus tard, après une reconversion vers des études d’anthropologie, je repartais là-bas pour mon premier terrain (juillet-octobre 2003).
Ali Abdallah Saleh était président du Yémen. Il y avait son portrait à l’aéroport, sur de grands panneaux publicitaires et en pleine page dans les journaux ; accroché dans toutes les institutions publiques, bien sûr, et parfois aussi dans les boutiques des avenues.
Ali Abdallah Saleh était toujours président en juillet 2010, lors de mon arrivée pour mon septième séjour, dont je ne savais pas encore qu’il serait le dernier.
J’arrive à Taez un jeudi soir (22 juillet 2010). Le lendemain en fin de matinée, je fais le tour de la maison pour toquer à la porte de Yazid, afin que nous nous rendions ensemble à la mosquée. Yazid grogne derrière la fenêtre, me dit d’attendre cinq minutes le temps qu’il se lave. Puis le voilà qui sort tiré à quatre épingles, un badge à sa boutonnière avec le portrait du Président. Yazid arbore un sourire coquin, comme un enfant qui vient de faire une bêtise. Je prends ça pour une blague, ce ne peut pas être autre chose : il a fait ça pour me tester… « Qu’est-ce que c’est que ça ?! », dis-je en riant, et je lui enlève le badge d’autorité. Yazid le remet dans sa poche et nous partons à la mosquée.
Résumé des épisodes précédents
Quand j’ai connu Yazid, en 2003 ou 2004, il était garçon de café, ou peut-être mécanicien, quelque part dans une autre région du pays. Yazid s’enorgueillissait d’être un travailleur, de son indépendance financière vis-à-vis de son frère aîné Nabil, qui avait un gros poste à la Municipalité. Entre les deux il y avait Ziad, le frère cadet, expert-comptable de profession. Lui, ça ne le gênait pas de recevoir l’argent de Nabil, pas plus d’ailleurs que de recevoir le mien.
Sept ans plus tard, tout avait changé. Ziad avait mis fin à sa carrière d’expert-comptable pour devenir une sorte de derviche, tandis que Yazid acceptait finalement que Nabil lui paie son mariage. « Profites-en, parce que je ne suis pas éternel… », l’avait-il prévenu. Et de fait quelques mois plus tard, Nabil décédait dans un accident de voiture.
En 2009, Yazid s’était finalement lancé dans la politique en tant que chef de quartier (‘âqil°), représentant local de l’administration. En charge de sa femme avec déjà deux enfants - ainsi que ses vieux parents, puisque Ziad n’assumait plus rien - il ne pouvait plus partir comme avant, travailler par monts et par vaux, où le travail était plus lucratif. Des mécaniciens et des garçons de café, il y en avait ici bien suffisamment, qui gardaient leur famille au village et n’avaient pas les mêmes charges que lui. Dans la ville où il avait grandi, Yazid ne pouvait faire d’autre travail : il devait travailler avec le Régime.
Par ailleurs l’année précédente, Yazid et moi étions devenu très proches. Yazid comprenait vaguement que leur histoire était aussi un peu la mienne, et que j’allais être amené à revenir régulièrement. Au printemps 2009 j’avais en outre obtenu un prix du CNRS, et c’est ce qui l’avait décidé à faire le pas : en quelques jours, il avait rassemblé les signatures de ses voisins. Quelques mois plus tard, il m’avait proposé de construire ma pièce à l’étage - pièce dans laquelle je venais de passer ma première nuit, ce fameux vendredi matin (23 juillet 2010).
Le contentieux de la pièce
Je regrette ma réaction face à ce badge, mais il est trop tard : Yazid ne me regarde plus en face. Pour traiter avec moi il envoie Ramzi, son homme de main. Depuis ce jour, sa seule obsession est d’obtenir mon départ de cette pièce, qu’il m’a pourtant proposé de construire, et que j’ai pourtant payée.
Au mois d’octobre, j’ai fini par me retirer dans mon hôtel habituel sur le carrefour, dans l’espoir de renouer le dialogue, mais toujours en vain. Voyant que je n’abandonne pas, Yazid fait sortir son frère Ziad, qui croupissait jusque là en prison. Le contrat selon lui, c’était que je construise une pièce pour Ziad…
Moi je n’en démords pas : je veux qu’il me rembourse. À l’intérieur de cette pièce, il y a toujours un coffre avec mes affaires ainsi que quelques meubles. Je m’apprête à revenir en France, pour un colloque fin novembre, et je ne veux pas laisser cette histoire en plan. Je ne veux pas rentrer en France et croire encore à ce pied-à-terre - car à coup sûr je nourrirai encore l’espoir de me croire attendu. Finalement, je pose à Yazid un ultimatum d’une semaine, pour me rembourser le coût de la construction.
Tout le quartier est au courant. On sait bien que Yazid n’a pas les moyens, qu’il ne va pas s’endetter pour honorer cette dette, que ce Français finira par repartir dans son pays. Yazid se terre chez lui une semaine.
Le 10 novembre 2010 en fin de matinée, le délai ayant expiré, je retourne dans le quartier. Cette fois Yazid sort et me frappe, balance le coffre par le balcon, et me fait jeter sur le carrefour par ses hommes de main. Tout se décide alors en quelques minutes. Quelques hommes de peine m’aident à porter le coffre cabossé jusqu’à l’épicerie d’al-Ra’wi, qui l’accueillera dans sa réserve. Je remonte à l’hôtel, boucle ma valise, et m’invite à déjeuner chez Lotfi. Son frère Marwan m’accompagnera au bus, qui part de Gawlat al-Qasr1) à 14h. Installé dans le bus, alors que le paysage défile, je pleure d’émotion et de bonheur. Cette fois je sais que je ne reviendrai plus, avant d’avoir été entendu dans mon propre pays : cette fois je sais que j’en aurai la force. Je remercie Dieu et je pleure, au fond, de me savoir libéré.
La structure qui relie
« Quelle est la structure qui relie le crabe au homard et l’orchidée à la primevère ? Et qu’est-ce qui les relie, eux quatre, à moi ? Et moi à vous ? Et nous six à l’amibe, d’un côté, et au schizophrène qu’on interne, de l’autre ? »
Gregory Bateson, La Nature et la Pensée (citation n°5).
Laissons de côté le crabe et la primevère, si Bateson le veut bien.
Dans cette petite histoire, quelle est la structure qui relie cette fratrie, le CNRS, le portrait du Président et moi ?
Une démarche scientifique
Revenons d’abord à cette question méthodologique fondamentale, que je posais dans l’un de mes premiers textes en février 2004 :
1. Ai-je vraiment observé plus que le simple effet de ma présence sur le terrain ?
2. Suis-je en mesure de contrôler les effets de mes affects sur mes résultats ?
Et Florence Weber, alors ma tutrice à l’ENS, gribouillait dans la marge cette réponse :
La question se divise en deux :
- Effet de mes affects sur l’observation = énorme.
- Effet de mes affects sur l’analyse = nulle.
« Le Za’îm d’une génération », annoté par Florence Weber
(voir en haut et en bas de la page 2).
Nulle. Florence Weber ne dit pas : « l’influence est moindre ». Elle ne dit pas : « elle est évitable par 500 pages d’introspection, si vous faites une psychanalyse en parallèle ». Non. Elle dit : si vous vous en donnez les moyens, si vous affrontez lucidement vos matériaux, alors l’influence est nulle. Voilà la réflexivité d’enquête* façon Florence Weber, et c’est dans cet esprit que j’écris ma maîtrise.
Sauf qu’une fois le mémoire déposé (juin 2004), quelque chose craque dans ma vie intime, car il m’est inconcevable de ré-éditer l’aventure. Je crois toujours aux sciences sociales, plus que jamais en fait. Mais si l’objectivité existe, si je l’ai touchée du doigt, alors je dois retourner là-bas. Même si je dois pour cela m’avouer « homosexuel ».
Quatre ans plus tard en troisième année de thèse, j’ai reconstruit mon questionnement en termes d’homoérotisme* avec ma directrice Jocelyne Dakhlia, pour arriver exactement au même point. D’ailleurs l’une et l’autre soutiennent ma candidature au Prix Michel Seurat, intitulée : « Le miel sur le rasoir. Une ethnographie du jeu et du fantasme dans la sociabilité masculine de l’urbanisation yéménite ». Et qu’est-ce que j’écris dans ce texte, en vue d’obtenir une rallonge de financement ? Que mon terrain est fini, mes matériaux récoltés, mais j’ai besoin d’un peu plus de temps pour mener l’analyse jusqu’à son terme. Je veux que l’influence de mes affects soit nulle. Qu’on comprenne qu’il n’y a pas « d’homoérotisme » dans la société yéménite, seulement dans la relation entre cette société et l’observateur.
Je rédige ce texte au Yémen, où je vis avec Yazid une sorte d’idylle, depuis l’expédition à Hammam Kresh. Mais cette idylle m’impose de revenir en France rédiger ma thèse. Je sais très bien que sans financement stable, ma relation avec ce quartier n’est pas tenable. C’est pourquoi Yazid, Ziad et leurs voisins, me font une cérémonie d’adieux en grande pompe. À ce stade, l’effet de mes affects sur l’observation est nul. La caméra est sortie pour l’occasion, le 17 novembre 2008, pour enregistrer précisément cela : capturer la structure qui relie entre cette fratrie, moi, le CNRS…
Le problème est que ces images n’ont jamais été vues. Ces textes n’ont jamais été lus. On ne peut pas me reprocher de ne pas avoir écrit ma thèse : je n’ai fait que ça les années suivantes, comme Don Quichotte, me battre contre des moulins… Je m’étais bien juré, en envoyant l’argent de la pièce, de ne pas retourner l’habiter avant d’avoir soutenu. Mais en juillet 2010, j’étais déjà épuisé. En bon Occidental, j’ai considéré avoir tout de même mérité mes vacances au bled…
Un musulman diplômé
Cette même année j’ai revu Fuwwâz, l’ami de promo et « disciple » de Ziad en 2003, qui travaillait depuis dans le management des ressources humaines en Arabie Saoudite. Vers la mi-septembre, il avait descendu sa famille à Sanaa avec sa belle voiture, pour la fin du Ramadan, et il était passé plusieurs fois à Taez pour voir ses vieux parents.
Fuwwâz restait marqué par l’histoire de son ami Ziad, par la manière dont celui-ci avait soudain perdu sa combativité (rûh al-qitâl), plus ou moins en lien avec la rencontre du Français. Il me voyait toujours là sept ans plus tard, et bien sûr qu’il en était touché. Bien sûr qu’il souhaitait jouer son rôle lui aussi, afin que cette histoire débouche sur quelque chose. À plusieurs reprises au cours de ce séjour, Fuwwâz a tenté de faire médiation entre Yazîd et moi, pour trouver un accord sur cette histoire de pièce, et que Ziad puisse sortir de prison.
C’était tout de même quelque chose que ce dernier séjour ! J’y repense aujourd’hui, en me replongeant dans ces notes que je n’ouvre jamais… Il y avait d’une part Yazid, qui dressait contre moi tous les jeunes du quartier - trop jeunes pour connaître vraiment l’histoire ; d’autre part sa tante et une partie de la famille qui prenaient ma défense en interne, représentés par Ammar. Et puis il y avait Fuwwaz, l’ami exilé. Toutes ces personnes s’activaient, pour que je puisse rédiger ma thèse dans cette pièce, ou toute solution équivalente. Car si je repartais cette fois encore, cette thèse ne serait évidemment pas la même, tous comprenaient parfaitement l’enjeu. Pourquoi donc ai-je été si intransigeant ? Pourquoi ai-je exigé que Yazid me rembourse ? Pourquoi dès mon arrivée, ai-je eu ce geste d’arracher ce badge ? Qu’est-ce au juste que je ne pouvais comprendre, ou qu’au contraire je comprenais trop bien ?
Dans cette histoire, la structure qui relie s’appelle Waddah. Cousin de Yazid d’une branche plus privilégiée, issue d’une autre femme du grand-père maternel, dont plusieurs enfants avaient fait carrière dans la Capitale (voir l’histoire de Maryam). Quand Waddah avait terminé ses études secondaires, une grande tante lui avait trouvé un poste dans la Capitale, employé dans une administration pour le compte de son « Oncle », un cadre du Régime. Il y était depuis quelques années à peine à l’époque de ma maîtrise, il avait encore la nostalgie du quartier. Et c’est un rôle bien particulier qu’avait joué Waddah, ou que je lui avais fait jouer plutôt, vers la fin de ce premier séjour :
4 octobre 2003, 6h du matin.
Dans la Capitale Sanaa, un ancien du quartier avec lequel je parle depuis 48 heures me réveille à l’aube pour me poser une question, que j’interprète sur le moment comme une proposition sexuelle. Après une réflexion d’une heure environ, au cours de laquelle je revisionne l’ensemble de mon séjour, je décide d’accepter cette proposition. Ce geste ouvre la voie à mon retour en France et à la rédaction de ma maîtrise, Le Za'îm et les frères du quartier…
Tel était dans mon enquête le visage du régime : un régime politique (lié à l’État yéménite) et indissociablement aussi épistémologique (lié aux sciences sociales). M’étant construit avec cette honte, il m’était simplement inconcevable de porter ce badge - pour autant j’assumais parfaitement mon histoire. D’ailleurs Waddah était là aussi, pour ces palabres de l’automne 2010, comme il avait été là deux ans plus tôt, lors de mes adieux en grande pompe devant la caméra. Tout le monde voulait trouver une solution en fait - à part Ziad qui persistait à être fou, à part moi qui persistais dans mes analyses.
Dans mon journal, j’ai noté comment Fuwwâz tentait de me coacher :
« Tu dois comprendre comment réfléchit Yazid ! Lui et ses amis, ils cherchent juste à préserver leur source de subsistance (rizq), et tu ne les changeras pas… En fait tu n’as pas de coeur, avec ton intransigeance, tu es comme les barbus ! Pourquoi n'es-tu pas copain avec eux ? Pour qu'ils te comprennent, tu dois les comprendre d’abord… »
Et je suis d'accord, je suis ravi que quelqu'un me fasse la leçon, mais en réalité il ne comprend rien.
(Notes du 28 septembre 2010)
Bien sûr à cette époque, nous ne parlions jamais d’Ali Saleh, de ce Régime qui semblait devoir durer l’éternité. Mais finalement, notre désaccord se ramenait à cette histoire de badge : pour ma part, je savais pertinemment que Yazid avait perdu la face ce jour-là (et à d’autres reprises les semaines suivantes - j’avais le retour de ‘Ammâr, ce qu’on disait de cette situation en interne dans la famille). J’étais prêt à négocier, à m’adapter, mais certaines démarches n’avaient juste pas de sens. Je savais qu'une relation transculturelle comme la notre ne pouvait être durable qu'en vertu d'un rapport de face. Je savais aussi que sans face, Yazid lui-même ne survivrait pas, dans la ligne de conduite qui était la sienne, qu'il en serait lui-même handicapé. D’ailleurs Yazid a eu pas mal de déboires les années suivantes - alors qu’il évitait de manière obsessionnelle tout contact avec moi, même téléphonique. Tombé sous l’influence de Ramzi, il n’a renoué avec moi qu’en 2013 après l’affaire Bassam, mais c’était trop tard. Au fond ma thèse n’a pas survécu à cette brouille. Car si le propre frère de Ziad se méfiait de moi comme de la peste, malgré ma conversion, comment pouvait-on croire en ma démarche ? Lors de ce dernier séjour, je tentais d’éviter précisément cela… Mais Fuwwâz ne comprenait pas.
En tant que diplômé, Fuwwâz portait déjà la chemise, il n’avait pas besoin de porter le Président en boutonnière. Ce badge n’était pas un problème pour lui, comme il pouvait l’être pour Yazid, et comme il l’avait été pour moi. Pour Fuwwâz, Ali Saleh était un problème « là dehors »GB8 : c’était le problème des autres, des Yéménites non-éduqués d’une part, d’autre part des Occidentaux sournois.
Pourtant dans nos discussions, il arrivait à Fuwwâz de douter parfois. Exilé depuis sept ans dans un pays développé, quelque chose de son propre pays semblait lui échapper par moments. Exactement comme Waddah à Sanaa en 2003, lors de nos premières discussions les 2 et 3 octobre. Pour Waddah aussi, il était insupportable de sentir que quelque chose lui échappait, dans les rapports de ce Français avec son propre quartier. D’où son geste au matin du troisième jour, sa démarche de me tester au réveil. Bien sûr l’incident ne pouvait se reproduire, avec personne d’autre. Mais à un certain stade Fuwwâz ne m’a plus contacté, et il ne passait plus dans le quartier de Yazid. Fuwwâz était toujours à Taez, mais il se concentrait sur ses propres parents.
Isolé dans mon hôtel, avec Ammar pour ultime interlocuteur, je ne faisais que travailler ma thèse, et nous sortions ensemble chaque après-midi, marcher sur les hauteurs du Djébel Sabir. Avec lui je reprenais toute mon enquête, toute l’histoire de leur famille et surtout de Nabil, dont Ammar avait été si proche, et auquel à l’évidence il m’associait. De ces discussions souvent intimes, j’ai tiré l’analyse de systémique familiale rédigée les années suivantes (« L’ethnologue et les trois frères de Taez, ou la chute des figures charismatiques dans le Yémen des années 2000 »). Au fond à ma manière à travers ce texte, à travers la figure de Nabil, j’avais fini par porter le badge du Régime.
Ali Abdallah Saleh est mort le 4 décembre 2017, soit encore sept années plus tard - mais sept années de révolution, de troubles, et finalement de guerre. Poussé vers la sortie en 2012, sous pression du Conseil de Coopération du Golfe, son pouvoir s’est éteint peu à peu comme une étoile déclinante, en décalage avec son temps. Mais la plupart des observateurs ne le comprenaient pas, et la tragédie est surtout venue de là. Yéménites comme étrangers, les observateurs enrageaient que Saleh continue en coulisses de tirer les ficelles : on restait persuadé que la situation finirait par retomber entre ses mains, et finalement rassuré quelque part par cette perspective. Le Yémen a touché le fond de cette manière, par l’attente toujours prolongée d’un retour au statu quo ante. Aussi, l’instant de sa mort fut un véritable choc : Saleh n’était pas censé mourir. Comme Nabil, comme ces hommes incarnant la structure qui relie, dont l’ombre sera refoulée jusqu’au dernier instant. Pour moi cependant, pour mon écriture, ce fut une libération…
« J'y suis pour rien! Je suis mort! » (avril 2018)
 Billet Mediapart sur la mort d'Ali Saleh
Billet Mediapart sur la mort d'Ali Saleh
1-3 octobre 2023
Index des Moments /
Retour
fr:comprendre: